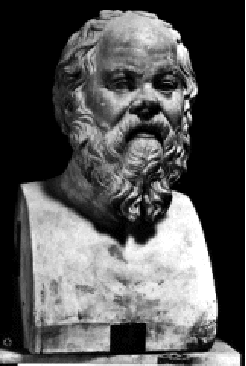- Il naît à Athènes, en 470,
c'est-à-dire à la fin des guerres médiques. Sa mère était
sage-femme et son père, Sophronisque, sculpteur. Il reçut sans doute
l'éducation de son temps, gymnastique, musique, école du
grammatiste. A-t-il suivi l'enseignement de tel ou tel philosophe ?
Peut-être, mais c'est peu probable.
- En tout cas, vivant au "siècle de Périclès", - le siècle
le plus brillant d'Athènes-, contemporain, ou presque, d'un Sophocle
et d'un Euripide, il a connu, au long de ses soixante-dix ans de vie,
la grandeur et la décadence de sa patrie.
- Il meurt en 399, quelques années
après la fin de la guerre du Péloponnèse et de la tyrannie des
Trente.
- Physiquement, il était fort laid (Xénophon)
: chauve, le nez épaté, il ressemblait à un satyre (Platon)
ou à un silène (Rabelais)
; ce visage scandalisait les Athéniens pour lesquels la beauté
physique était le symbole de la beauté morale.Sa tenue vestimentaire
(Platon)
était plus que simple (sans être provocante comme celle des
cyniques) et il portait rarement des chaussures...
- Nous ne savons rien sur la jeunesse de Socrate : peut-être
a-t-il d'abord exercé le métier de son père avant d'aller écouter
les philosophes...
Il épousa Xanthippe (Xénophon)
dont la tradition nous dit qu'elle était une femme acariâtre et dont
il eut trois fils.
La personnalité véritable de Socrate pose également une énigme ;
l'histoire de la philosophie grecque est, traditionnellement, organisée
autour de son nom et nous ignorons quel fut le véritable Socrate :
son disciple Xénophon en fait un portrait assez fruste et banal ; son
autre disciple, Platon, l'idéalise et lui prête ses propres
conceptions philosophiques, Aristophane le caricature dans sa pièce
Les Nuées (Aristophane).
Nous n'avons aucun écrit de Socrate car son enseignement était tout
oral.
- Dans la vie civile Socrate fait également preuve de courage : il
refuse de condamner en bloc les généraux qui n'avaient pas recueilli
les corps des naufragés à la bataille des Arginuses (406) et, en
404, sous la tyrannie des Trente, il critique ouvertement les exécutions
sommaires ordonnées par ceux-ci et refuse (Platon)
même de participer à une arrestation. Le courage de Socrate s'allie
à une maîtrise de soi en toute circonstance : il n'est jamais ivre
(même après avoir beaucoup bu ! ), ne s'emporte jamais et supporte
avec flegme injures ou critiques, à la grande admiration d'Alcibiade,
par exemple.
Cette attitude et ce caractère, les disciples qu'il s'est attachés,
lui ont donné une certaine notoriété qui ne va pas sans susciter
jalousies et envies. Sa méthode d'enseignement (cf. le
philosophe) et sa pratique ne sont pas de tout repos.
- Les esprits conservateurs voient en lui l'incarnation de l'esprit
nouveau, qui pervertit les vieilles valeurs morales et constitue
un danger pour l'ordre social. En 399 Socrate est accusé par Anytos
et deux acolytes dans les termes suivants : "Socrate est coupable
du crime de ne pas reconnaître les dieux reconnus par l'Etat et
d'introduire des divinités nouvelles ; il est de plus coupable de
corrompre la jeunesse". Le châtiment demandé est la mort.
Socrate refuse le secours de Lysias et de la plaidoirie qu'il avait préparée,
pour se défendre seul. Après délibération, Socrate est déclaré
coupable par 281 voix contre 278.
- L'institution judiciaire athénienne voulait que le condamné fît
une contre-proposition pour sa condamnation ; or Socrate, au lieu de
s'humilier comme le faisaient habituellement les condamnés, propose
pour sa conduite passée... d'être nourri au prytanée (honneur suprême
! ) pour le restant de ses jours. Cette réponse (Platon)
apparut comme un outrage aux juges et la condamnation à mort de
Socrate fut votée avec 80 voix de plus que ne l'avait été sa
culpabilité. Socrate dit alors un dernier adieu à ses juges en leur
promettant un châtiment beaucoup plus pénible : celui de voir croître
ses disciples (le récit de ce procès se trouve dans l'Apologie de
Socrate de Platon).
- Enfermé en prison, Socrate n'est pas exécuté immédiatement car
le vaisseau qui va tous les ans porter à Dèlos des offrandes à
Apollon vient de partir et aucune exécution capitale ne peut se faire
avant son retour ; pendant les trente jours de son emprisonnement
Socrate s'entretient avec ses disciples qui lui proposent en vain un
plan d'évasion (cf. Criton de Platon).
Le jour où il boit la ciguë, il consacre ses derniers moments (Platon)
à dialoguer avec ses amis sur l'immortalité de l'âme : ces propos
nous sont rapportés dans le dialogue du Phédon de Platon.
|
- Son enseignement n'a rien à voir avec celui d'un directeur d'école
philosophique ; son "école", c'est l'agora, la place
publique où il se promène au milieu des petites gens comme des
aristocrates, bavardant avec tous et les interrogeant, en
prenant comme sujets de méditation les mille et un problèmes de la
vie quotidienne.
Il va répétant qu'il a reçu comme mission (Platon)
de la part des dieux d'éduquer ses contemporains. Cet oisif, qui
n'exerce aucun métier et a choisi de vivre pauvre enseigne
gratuitement -contrairement aux sophistes qui faisaient payer fort
cher leurs leçons. Mais cet oisif ne se refuse pas pour autant à ses
devoirs de citoyen : il fait la campagne de Potidée au début de la
guerre du Péloponnèse, assiste à la défaite des Athéniens face
aux Thébains à Délion (424) où il sauve Xénophon.
- L’éducation, avec Socrate, est devenue une
question pour philosophes, parce qu’avec Socrate la philosophie même
est issue de la préoccupation d’un éducateur. Au milieu d’une époque
dure, où la Grèce s’entredéchire, où l’arrivisme et la désinvolture
des élites vont de pair avec la curiosité intellectuelle et
l’esprit d’entreprise, Socrate pose la question de la mesure :
que convient-il d’entreprendre et, plus spécifiquement, que
convient-il de prétendre enseigner ? Que convient-il de
projeter d’apprendre ? Qu’est-ce que la formation d’un
homme, pour un dessein à la fois singulier et pluriel ? La réponse
socratique sera que " le cheval vaut mieux que le mors "
(Platon, Lachès , 185d) : l’éducable vaut
mieux que les moyens dont on le dote. Voilà la naissance de l’homme
" bel et bon ", que les modernes appelleront à être
pour soi-même son propre éducateur, et dont les postmodernes
proclameront la mort.
|